Ahmad Jamal (1930-2023) - Un hommage à l’album Live at The Pershing
- Joss Tellier

- Nov 8, 2023
- 3 min read

Le 16 avril dernier, le pianiste Ahmad Jamal est décédé, à l’âge
de 92 ans. Je rappelle, pour l’anecdote, que c’est le pianiste
dont Miles Davis a dit qu’il jouait du piano “the way it should
be played”.
C’est mon ami Justin qui m’avait introduit à sa musique, il y a
presque vingt-cinq ans; c’était le trio des années cinquante, le
légendaire disque enregistré en public au Pershing Lounge,
contexte idéal pour cette musique s’il en est un: le lobby-bar
d’un hôtel de Chicago, un voyage dans le temps total, faisant
entendre, en plus de la musique, le bruit des verres qui
s’entrechoquent et ceux de la caisse enregistreuse, sans
oublier celui d’une foule bruyante qui ne manque pourtant pas
d’attention. On savait y faire pour passer du bon temps les
jeudis soirs dans la Chicago des fifties.

Un répertoire parfait, (Moonlight In Vermont dans sa version
définitive; Poinciana, pièce souvent reprise par d’autres mais
sans vraiment en reproduire le charme envoûtant) un time feel
impeccable, des arrangements orchestraux précis (rares chez
les piano-trios à l’époque - même de nos jours) et, surtout, ces
longues mesures où Jamal fait acte d’abstention - il savait
mesurer ses effets - qui gardent l’auditeur attentif; par peur
d’en manquer une peut-être, ou simplement à cause du vertige
créé par ces silences; plus probablement, grâce à la valeur
ajoutée à la parole de celui qui se tait au bon moment. De
celui qui sait.
L’homme aura joué jusqu’à la toute fin de sa vie. Endisquant
de manière soutenue, sur six décennies (!), jamais il n’aura
laissé son essence originelle se travestir ni se soumettre aux
diktats de la mode: Ahmad Jamal est identifiable dès la
première phrase mélodique entendue, et ce pour quiconque l’a
écouté un minimum. On songe ici aux grands écrivains ou aux
grands peintres; sa manière est évidente et reconnaissable.
Il y a ce sentiment, pour vous aussi peut-être: l’impression de
connaitre personnellement les artistes dont l’oeuvre m’est
chère, ceux à qui je dois ces endroits sûrs où je me sens
toujours bien; ceux avec qui la sensation d’être en lien pour
vrai est tangible et indiscutable, je l’ai écrit quelque part à
propos de Keith Jarrett. J’ai beau savoir que cette impression
est trompeuse, elle persiste et se révèle plus forte lorsque l’un
de ces artistes décède. L’écoute du disque Live At The Pershing
ce soir, pour me recueillir, ne m’éloigne pas d’Ahmad Jamal
(qui vient pourtant de mourir), au contraire: j’ai même
l’impression d’avoir été présent lors de l’enregistrement du
Pershing tant je le connais par coeur (impossible pour moi
d’avoir été là, en ce jeudi 16 janvier 1958 puisque je ne
naîtrais que quinze ans plus tard) et d’avoir, pour me consoler,
des souvenirs partagés avec Jamal; et qu’en fait certains sons
de verres à cocktails entrechoqués entendus sur le disque sont
ceux de mon verre à moi.

Quelle chance, tout de même, pour un artiste, de toucher
quelqu’un de manière aussi forte ! Entre Jamal et moi, il n’y
eût aucune rencontre réelle, je n’ai pas même vu un de ses
concerts, non: rien qu’un lien par le truchement d’un
phonogramme et pourtant Ahmad Jamal pouvait me compter
comme un ami, un ami fidèle en plus - d’ailleurs si j’avais reçu
un dollar pour chacune de mes écoutes, j’aurais de quoi me
payer l’avion pour assister à ses funérailles. L’amitié idéale en
quelque sorte, sans aucunes jalousies ni l’ombre d’un conflit à
signaler entre nous. La fréquentation d’un artiste sans
véritable rapport humain avec celui-ci (énorme paradoxe
rendu possible par l’art reproduit et domestiqué) : rien de plus
facile ! Je ne citerai pas Sartre à propos de l’Enfer ici - vous
m’avez bien compris.
Je crois que chaque artiste aspire à créer, ne serait-ce qu’une
fois, une oeuvre qui soit essentielle pour quelqu’un - et se
serait probablement suffisant pour effacer toutes les
mauvaises critiques, pour faire oublier tous les concerts,
tableaux, films, pièces et poèmes ratés au cours d’une carrière
artistique. Au rayon des rencontres véritables, je préfère croire
que la qualité l’emporte sur la quantité.
Pour mille détracteurs, une seule personne dont la vie ne
serait pas la même sans notre oeuvre m’apparaît être une
justification en même temps qu’une validation de l’importance
d’avoir mené à terme ce qui, bien avant d’être qualifiable de
fruit de notre travail, aura souvent été source de doute et
d’inconfort; à parts égales dans bien des cas.
On dit parfois à propos des projets auquels on se consacre
qu’il faut, le moment venu, “laisser partir le bébé” - accepter
l’imperfection, publier l’oeuvre et continuer notre parcours;
pour pouvoir créer la suite de l’oeuvre-histoire qui est la nôtre.
Heureusement que l’enregistrement (tout bruyant, distortionné
et documentaire qu’il puisse être) du Pershing Lounge a été
publié, livré au monde sans fard, et de ce fait rendu possible à
connaître, pour potentiellement changer des milliers de vies,
dont une : la mienne.
- Joss Tellier


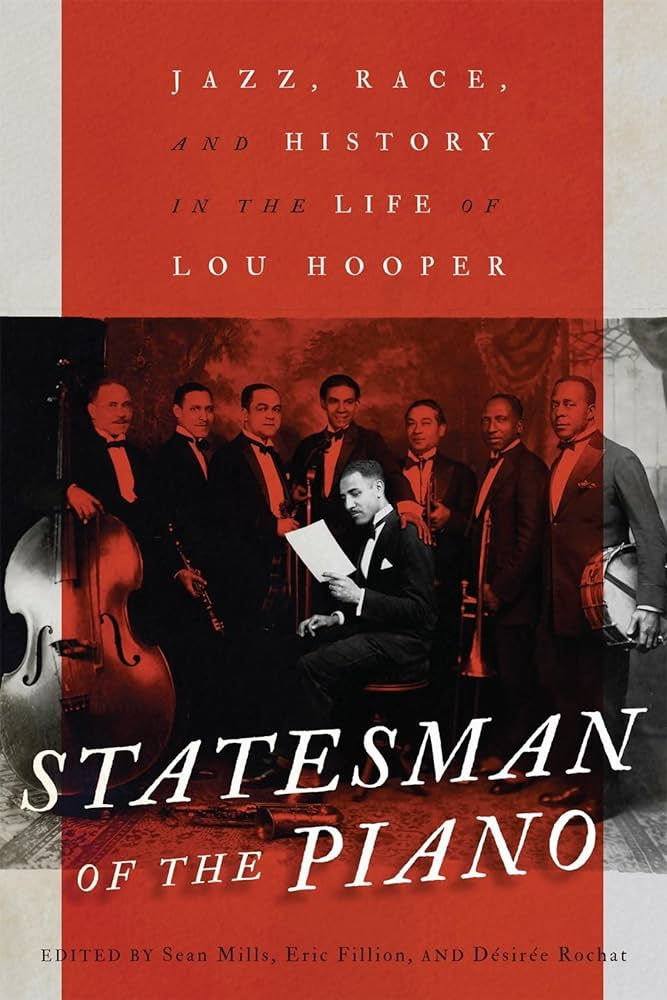

Comments